Entre 2019 et 2025, le Sénégal a accordé des exonérations fiscales massives, estimées à plusieurs centaines de milliards de francs CFA, à des entreprises nationales et multinationales opérant principalement dans les secteurs stratégiques du pétrole, gaz, mines, télécommunications et zones franches. Ces exonérations, souvent sans contrepartie claire ni évaluation d’impact, ont creusé un manque à gagner important pour les finances publiques, dans un contexte de pression sociale croissante et de besoins urgents en infrastructures, santé, éducation et emploi.
Les dépenses fiscales ont ainsi représenté 750,3 milliards FCFA en 2019, soit près de 30 % des recettes fiscales et 5,4 % du PIB, pour progresser à 846,1 milliards en 2020, puis à 952,7 milliards en 2021. Sur la période 2015–2019, le cumul des exonérations atteignait 3 447 milliards FCFA selon la direction générale des impôts et domaines. Pourtant, aucune étude publique d’impact n’a démontré la pertinence économique de ces allègements.
Les bénéficiaires de ces régimes sont peu identifiés. Les dispositifs fiscaux en vigueur, tels que le code des investissements, le code minier, le code pétrolier ou les mesures pour les entreprises exportatrices, profitent majoritairement à des multinationales étrangères, qui bénéficient d’exonérations sur l’impôt sur les sociétés, la TVA, les taxes foncières et les contributions patronales. Par exemple, dans le secteur pétrolier, certaines entreprises ont été exonérées de plusieurs taxes pendant la phase d’exploration et au-delà des trois premières années de production.
La transparence fait défaut et aucun rapport annuel officiel n’a été publié entre 2022 et 2023, malgré les obligations réglementaires de l’UEMOA. La Cour des comptes pointe un manque de données fiables, tandis que l’administration fiscale invoque des « contraintes liées à la disponibilité des données », renforçant les suspicions de mauvaise gestion.
Selon le natural resource governance institute, le Sénégal pourrait perdre jusqu’à 153 millions de dollars par an en raison de la sous-facturation, du transfert de bénéfices et d’autres formes d’évasion fiscale pratiquées par certaines multinationales, alors que ces dernières devraient représenter jusqu’à 9 % des recettes fiscales nationales à terme.
Parallèlement, la fraude et l’optimisation fiscale génèrent chaque année environ 161 milliards FCFA de pertes pour l’État, soit plus de 5,6 % des recettes budgétaires hors dons. Ces pertes sont aggravées par une fiscalisation insuffisante du secteur informel, qui transfère la charge fiscale principalement vers les petites entreprises et les ménages.
Pour attirer les investissements étrangers, le Sénégal a entrepris plusieurs réformes structurantes avec l’adoption d’un nouveau code des investissements, la création de zones économiques spéciales, et la mise en place de partenariats public-privé. Ces mesures ont favorisé un afflux d’investissements directs étrangers, concentrés à 36,3 % dans les secteurs minier, pétrolier et gazier entre 2014 et 2023. Or, ces secteurs restent dominés par des multinationales peu intégrées dans les chaînes de valeur locales, bénéficiant de régimes fiscaux très avantageux.
Le pays accueille ainsi d’importants acteurs internationaux comme BP, Woodside, TotalEnergies dans les hydrocarbures, Endeavour mining dans les mines, Orange et Free dans les télécoms, ou Auchan et Carrefour dans la grande distribution. Ces groupes jouent un rôle économique majeur, mais leur contribution fiscale réelle est difficile à apprécier en raison du manque de transparence.
Entre 2019 et 2025, le Sénégal a octroyé d’importantes exonérations fiscales à plusieurs multinationales actives dans les secteurs des hydrocarbures, des mines, des télécommunications et de la grande distribution. Ces avantages fiscaux, inscrits dans des régimes dérogatoires ou des conventions d’investissement, ont eu un impact significatif sur les recettes publiques du pays.
Dans le secteur des hydrocarbures, les entreprises BP, Woodside et TotalEnergies ont bénéficié de régimes fiscaux très favorables dans le cadre de leurs contrats de partage de production et de la législation pétrolière sénégalaise. En 2024, la société australienne Woodside, opérateur du projet Sangomar, a contesté une réclamation fiscale de 41 milliards de francs CFA émise par la direction générale des impôts et domaines du Sénégal, portant notamment sur des exonérations jugées excessives en matière de TVA, de droits de douane et d’autres contributions. Cette affaire, portée devant la justice sénégalaise, illustre la difficulté pour l’État de recouvrer certains impôts dans le contexte de conventions fiscales stabilisées à long terme.
Dans le secteur minier, Endeavour mining, principal acteur de l’or avec son projet Sabodala-Massawa, a versé environ 39 millions de dollars d’impôts et de redevances au premier trimestre 2025, tout en continuant à bénéficier de plusieurs avantages fiscaux. Les conventions minières permettent aux entreprises de bénéficier d’exonérations sur la TVA, les droits de douane et certaines taxes locales pendant les phases de recherche et les premières années d’exploitation. Malgré ces exonérations, Endeavour a généré, sur l’année 2024, près de 162 milliards de FCFA de revenus au Sénégal, Côte d’Ivoire et Burkina Faso combinés, selon ses rapports financiers. Cependant, une part importante de ces revenus est soumise à des régimes préférentiels qui limitent la contribution fiscale directe.
Dans le secteur des télécommunications, les opérateurs Orange et Free sont éligibles au statut d’Entreprise Franche d’Exportation, lorsque plus de 80 % de leur chiffre d’affaires est réalisé à l’international. Ce statut permet un taux d’impôt sur les sociétés réduit à 15 % au lieu de 30 %, ainsi qu’une exonération de la contribution économique locale, de la patente, des droits d’enregistrement et des taxes à l’importation. Ces exonérations ont été prolongées jusqu’en 2025, conformément aux dispositions de la loi de finances sénégalaise. Elles représentent un levier d’attractivité, mais aussi une source de perte de recettes pour l’administration fiscale.
Dans le domaine de la grande distribution, les groupes Auchan et Carrefour sont implantés dans des zones économiques spéciales, notamment à Diamniadio, et bénéficient d’un régime fiscal très favorable. Ces entreprises sont soumises à un taux d’impôt sur les sociétés de 15 % au lieu de 30 %, et sont exonérées de TVA, de droits de douane, d’impôt foncier, de taxes d’affaires et de contributions sociales pendant une période pouvant aller jusqu’à 25 ans.
Le secteur extractif, bien que ne représentant qu’une faible part du PIB, constitue une source croissante de revenus publics, avec 5 à 6 % des recettes totales en 2019-2020 et une contribution attendue de 8 à 9 % dans les années à venir, portée par le développement du pétrole et du gaz. Pourtant, ce secteur est lourdement affecté par les flux financiers illicites.
Chaque année, le Sénégal perd entre 1 % et 12 % de ses recettes fiscales à cause de pratiques telles que la fausse facturation commerciale, le transfert de bénéfices et l’abus de conventions fiscales, notamment avec Maurice. La fausse facturation est estimée entre 57 et 153 millions de dollars annuels, ce qui suffirait à doubler le budget des transferts sociaux vers les ménages vulnérables. Le transfert de bénéfices a coûté 2,3 % du PIB en 2013, et 45 millions de dollars en 2019. Sur 17 ans, les abus de conventions fiscales ont fait perdre 257 millions de dollars.
Ces pertes s’ajoutent à une capacité de contrôle fiscal faible en 2020, le Sénégal comptait 78 agents du fisc par million d’habitants, se classant 134e sur 150 pays. En 2021, seuls 2,6 % des fonctionnaires étaient affectés au contrôle fiscal, plaçant le pays parmi les derniers au monde. La structure des coûts dans l’extraction est également problématique, avec 45 % des revenus captés par les sous-traitants dans les mines et 26 % dans le pétrole. Une part significative de ces sous-traitants est enregistrée dans des juridictions à faible fiscalité comme l’Irlande, la Suisse, Maurice ou Singapour, rendant la traçabilité des bénéfices difficile.
Le régime fiscal minier impose un impôt sur les sociétés de 30 % pour les permis d’exploitation, mais exclut l’imposition pour les permis de recherche. Les exonérations sont nombreuses, sur impôt minimum forfaitaire modulé selon la taille de l’entreprise, exonérations durant les premières années, redevances minières entre 1 % et 5 %, exonérations d’exportation sauf une contribution spéciale de 2 à 3 %, exonérations douanières jusqu’à 15 ans. Ces mesures, couplées à des plafonds sur les déductions d’intérêts, sont difficiles à contrôler en pratique.
Au plan international, le Sénégal est fortement exposé aux flux financiers illicites. En 2018, il se classait 23e sur 111 pays en développement selon Global financial integrity en proportion de ces flux, et 19e pour les pertes fiscales en pourcentage du PIB. Ces pertes, même modérées en valeur relative, ont un impact significatif sur un budget national restreint.
En 2021, les exonérations fiscales ont culminé à 952,7 milliards FCFA, soit 6,2 % du PIB et 37 % des recettes fiscales, avec le secteur extractif recevant 391 milliards (41,1 % du total), dont 178 milliards de TVA non perçue, 126 milliards pour le régime pétrolier et 24,2 milliards en droits de douane. Ces exonérations excédaient largement les recettes effectives du secteur, qui s’élevaient à 223 milliards. Depuis, les exonérations ont diminué, atteignant 454,8 milliards en 2022, 391,7 milliards en 2023, et 96,4 milliards au premier trimestre 2024.
La stratégie nationale de développement 2025–2029 prévoit une rationalisation des dépenses fiscales, mais les exonérations accordées jusqu’en 2025 questionnent la capacité du Sénégal à mobiliser ses ressources propres. Face à cela, le FMI et d’autres partenaires recommandent une réduction des dépenses fiscales avec un objectif de 100 milliards FCFA d’économies annuelles. Toutefois, ces mesures arrivent tardivement alors que les déficits budgétaires ont explosé, la Cour des comptes ayant relevé un creusement du déficit de 5,6 points de PIB entre 2019 et 2023, et l’endettement public passant de 74,4 % à 99,7 % du PIB fin 2023.
Le cadre légal sénégalais ne comporte pas de loi spécifique sur l’exonération des multinationales, mais repose sur un code général des Impôts offrant de nombreuses incitations fiscales accessibles aux entreprises, y compris les filiales de groupes étrangers. La réforme récente du CGI vise à améliorer la lisibilité, l’efficacité, la justice fiscale et le consentement à l’impôt, en rationalisant les régimes spéciaux issus du code minier, pétrolier, investissements, zones franches, etc.
Le système prévoit des avantages généraux comme le crédit d’impôt, des réductions pour exportation ou pour investissements, ciblant notamment les entreprises industrielles, agricoles ou de services exportateurs, souvent intégrées dans des chaînes de valeur dominées par des multinationales. Les déductibilités spécifiques à l’impôt sur les sociétés incluent les œuvres sociales, cotisations aux régimes complémentaires, amortissements liés aux partenariats publics-privés. Pour la TVA, plusieurs mécanismes incitatifs ont été conservés ou ajustés, incluant la suspension dans le cadre du code des investissements.
Les mesures incitatives concernent les entreprises investissant au moins 100 millions FCFA dans des secteurs prioritaires (agriculture, pêche, santé, tourisme, éducation), avec des déductions d’impôt jusqu’à 40 % voire 70 % hors Dakar, exonérations liées à la création d’emplois pouvant durer jusqu’à huit ans. Les régimes spécifiques restent actifs pour les multinationales dans les secteurs minier, pétrolier et zones franches, offrant des exonérations sur la contribution patronale, la contribution foncière et la patente, cumulables dans certaines limites.
Pour lutter contre l’évasion, la réforme a renforcé le contrôle sur les prix de transfert, avec une obligation de documentation détaillée des transactions intra-groupes dans des juridictions à fiscalité privilégiée.
Si aucune disposition ne cible exclusivement les multinationales, le système leur est favorable par un ensemble d’incitations générales et sectorielles. Le défi actuel est de concilier attractivité économique et mobilisation fiscale équitable, face à une demande sociale croissante et une pression budgétaire intense.
Stratégies d’évasion fiscale, montages juridiques et pertes pour l’État
Au Sénégal, les multinationales opérant dans les secteurs stratégiques comme le pétrole, le gaz, les mines, les télécommunications, les BTP et la grande distribution mettent en œuvre des stratégies complexes de contournement fiscal, en toute légalité apparente. Ces pratiques, souvent tolérées ou mal encadrées, provoquent une hémorragie de recettes fiscales pour un État confronté à des défis économiques majeurs et à une forte demande sociale.
Parmi les techniques les plus courantes figure la sous-facturation commerciale. Elle consiste à déclarer des prix artificiellement bas pour les importations ou les exportations, réduisant ainsi la base imposable. Les importations sénégalaises seraient sous-déclarées d’environ 5 %, causant une perte annuelle estimée à 36 millions de dollars en droits de douane. Le secteur aurifère, lui, enregistre une sous-évaluation chronique de ses exportations, avec un manque à gagner d’environ 21 millions de dollars par an en impôts sur les sociétés. En 2021, les exportations d’or vers les Émirats arabes unis ont été vendues en moyenne 59 % moins cher que dans d’autres destinations, générant une perte fiscale estimée à 12 millions de dollars. Fait troublant, les douanes des Émirats déclaraient pour l’or sénégalais des valeurs à l’import supérieures de plus de 60 % à celles enregistrées par le Sénégal à l’export, alors que les écarts logistiques classiques ne dépassent pas 6 %.
Autre mécanisme répandu, le transfert de bénéfices. Les entreprises déplacent artificiellement leurs profits vers des filiales basées dans des juridictions à faible fiscalité afin de réduire leur imposition au Sénégal. Cette stratégie est favorisée par des conventions fiscales bilatérales souvent déséquilibrées. L’accord signé avec l’île Maurice, par exemple, aurait généré une perte de 257 millions de dollars sur dix-sept ans, en permettant aux entreprises de ne payer aucun impôt ni au Sénégal, ni dans la juridiction partenaire.
Les prix de transfert constituent un autre levier puissant d’optimisation. Les multinationales fixent des prix internes pour les biens et services échangés entre leurs filiales, souvent déconnectés de la réalité du marché. Ces montages leur permettent de gonfler les charges de leurs entités sénégalaises, réduisant ainsi leurs bénéfices imposables. L’absence de documentation solide et les capacités très limitées de l’administration fiscale rendent difficile tout contrôle efficace.
La structure des sous-traitants et fournisseurs est aussi utilisée pour faire sortir discrètement les bénéfices du pays. Une part importante de ces entreprises, parfois créées localement, sont en réalité enregistrées dans des pays comme l’Irlande, la Suisse, Maurice ou Singapour. Cela rend la traçabilité des flux financiers très complexe. Dans le secteur minier, les paiements aux fournisseurs représentaient 64 % de la valeur totale de la production en 2020, laissant penser qu’une part importante des richesses extraites échappe à l’impôt.
Le recours aux régimes dérogatoires aggrave le manque à gagner pour l’État. De nombreuses entreprises bénéficient d’exonérations fiscales prolongées au-delà de la phase initiale d’investissement. Les exonérations sur la TVA, les impôts sur les sociétés, les droits de douane ou la contribution foncière sont souvent cumulées sans contrôle ni évaluation publique. Ces privilèges, qui devaient être temporaires, deviennent dans certains cas structurels.
Derrière ces mécanismes fiscaux, se cachent aussi des montages juridiques élaborés. Nombreuses multinationales créent des structures hybrides avec des citoyens sénégalais jouant le rôle de prête-noms, c’est le cas de la liste des bénéficiaires effectifs des entreprises minières, jamais publiée par le gouvernement du Sénégal. Cela leur permet de bénéficier des avantages réservés aux entreprises locales, comme l’accès aux marchés publics ou certaines exonérations. Les formes juridiques les plus courantes sont les SARL, majoritairement détenues en apparence par des Sénégalais mais en réalité contrôlées par la maison-mère, les groupements d’intérêt économique, ou encore des succursales enregistrées au nom de partenaires locaux, mais opérant comme des filiales déguisées.
D’autres entreprises montent des sociétés de prestation ou de sous-traitance avec des associés sénégalais, pour surfacturer des services fictifs ou transférer des fonds à l’étranger. Il s’agit parfois de cabinets de conseil, de logistique ou de services IT, qui n’ont qu’un rôle de relais comptable. Ces structures servent à surévaluer les charges et à minorer les bénéfices imposables.
Les pratiques de rémunération intra-groupe accentuent encore la fuite fiscale. Les filiales locales versent à leur maison-mère des redevances de marque, des frais de gestion ou des intérêts sur des prêts internes. Bien que la législation sénégalaise ait instauré des plafonnements sur ces types de déductions, leur application reste aléatoire en raison du faible nombre d’agents de la Direction générale des Impôts. En 2020, le Sénégal comptait à peine 78 agents du fisc par million d’habitants, se classant au 134e rang mondial.
En parallèle, les multinationales opérant dans des zones économiques spéciales ou sous les régimes du code minier ou pétrolier bénéficient d’exonérations pouvant aller jusqu’à quinze ans. Ces entreprises jouissent aussi de larges déductions fiscales sur les investissements, parfois jusqu’à 70 % dans les régions hors de Dakar, et de suspensions de TVA sur l’importation de biens. Elles peuvent cumuler ces avantages dans la limite de 50 % du bénéfice imposable, avec possibilité de report indéfini.
Ces régimes sont aussi soutenus par des dispositions du code général des impôts, censées encourager l’investissement mais qui, dans les faits, favorisent la captation des ressources par des entités étrangères. Les exonérations liées aux partenariats public-privé, les déductions pour œuvres sociales, ou les allègements de charges patronales bénéficient en majorité à des entreprises bien structurées, souvent liées à des groupes internationaux.
Les conséquences de ces pratiques sont lourdes. Le budget national est privé de centaines de milliards de francs CFA chaque année, limitant les capacités de l’État à financer les infrastructures, la santé ou l’éducation. La pression fiscale reste concentrée sur les petites entreprises et les ménages, accentuant les inégalités. L’évasion et l’optimisation fiscales sapent aussi la crédibilité de l’État et freinent la mobilisation des ressources internes.
La justice fiscale reste l’un des grands défis du Sénégal moderne. Loin d’être une simple affaire technique, elle pose la question de la souveraineté économique, de la transparence, et du contrat social dans un pays en pleine mutation mais encore vulnérable à l’influence de grandes entreprises dont les pratiques sapent les fondements mêmes du développement durable.
Par Zaynab SANGARÈ
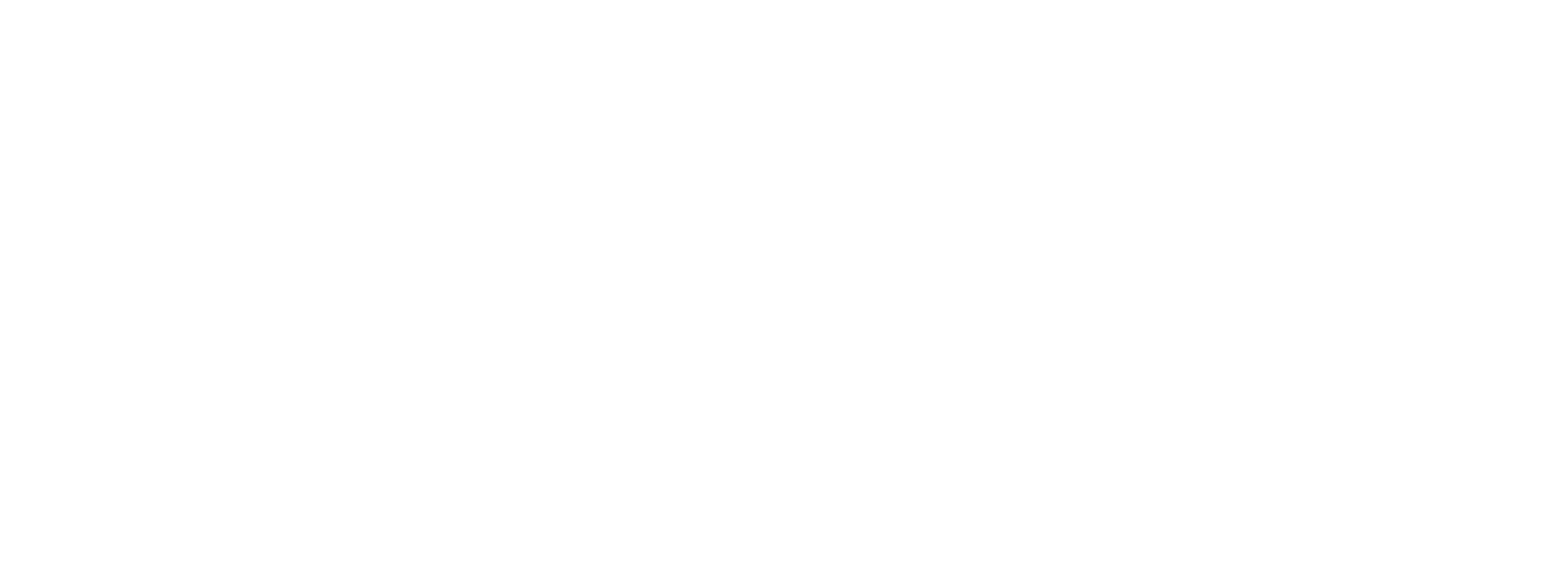
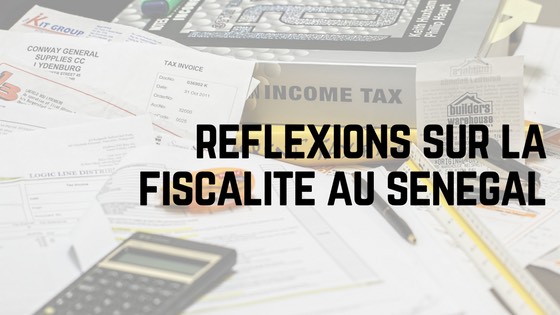





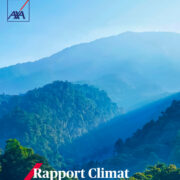



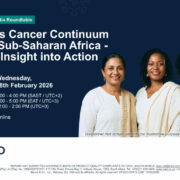


I reckon something truly special in this internet site.