La pollution plastique est partout. Plusieurs alertes ont déjà été lancées. Mais la Fondation Tara Océan va aujourd’hui un peu plus loin encore. Parce qu’elle a embarqué des chercheurs dans une folle aventure sur les fleuves d’Europe. Et qu’ils en sont revenus avec des chiffres inquiétants.
Au sommaire
- Des légions de microplastiques invisibles dans nos fleuves
- Les microplastiques, un risque pour notre santé ?
Lorsque la Fondation Tara Océan est lancée en 2003, c’est à la fois pour mieux comprendre et mieux protéger les océans du monde, tellement essentiels à l’équilibre de notre Terre. En 2009, une équipe part ainsi à la rencontre du monde planctonique. « Et en cherchant du plancton, nous avons trouvé des plastiques », se souvient Romain Troublé, directeur général de la Fondation. Alors, réflexe de scientifiques, les chercheurs ont commencé à les compter, les mesurer. Jusqu’à lancer une première alerte en 2014. Les données montraient alors que notre belle bleue, la Méditerranée, est la mer la plus polluée aux microplastiques du monde.
C’est de là qu’est née l’idée d’une « Mission Tara Microplastiques ». Une mission qui irait chercher, vers les continents, les origines de cette pollution. En remontant les plus grands fleuves d’Europe.

La Mission Tara Microplastiques a prélevé des échantillons à différents endroits de neuf fleuves d’Europe. Ici dans le Tibre (Italie) : au large, dans l’estuaire, dans une eau à salinité intermédiaire, en aval de la première grande ville et en amont de cette ville. © Fondation Tara Océan
Entre mai et novembre 2019, des chercheurs ont ainsi parcouru 17 000 kilomètres pour prélever un total de près de 3 000 échantillons dans la Tamise (Royaume-Uni), l’Elbe (Allemagne), le Rhin (Allemagne), la Seine, la Loire, la Garonne et le Rhône (France), l’Ebre (Espagne), le Tibre (Italie). Et en extraire tous les microplastiques. Un travail fastidieux, car il a fallu, parfois, pour les grands microplastiques, procéder à la pince à épiler. « Pour les petits microplastiques, nous avons développé une méthode à base de pyrolyse, de chromatographie et de spectroscopie de masse pour peser plus que compter », explique Alexandra Ter Halle, directrice de recherche au CNRS.
Le saviez-vous ?
Les scientifiques qualifient de grands microplastiques, les morceaux de plastique dont la taille est comprise entre 5 et 0,5 millimètre – soit entre 5 000 et 500 micromètres. Ceux qui restent visibles à l’œil nu. Ils classent dans la catégorie des petits microplastiques ceux dont la taille est comprise entre 0,5 et 0,025 millimètre – soit entre 500 et 25 micromètres. Ils sont invisibles à l’œil nu.
C’est pourquoi il aura fallu patienter aussi longtemps pour connaître les résultats. Ils sont publiés aujourd’hui dans la revue Environmental Sciences and Pollution Research. Sous la forme de pas moins de 14 études. Et la conclusion générale de cette Mission Tara Microplastiques, c’est que tous les fleuves d’Europe sont pollués. Les chercheurs y ont trouvé une moyenne de 3 microplastiques par mètre cube. « Pour vous faire une idée, cela veut dire qu’à chaque coup d’œil d’une seconde que vous jetez à la Seine, ce sont quelque 900 microplastiques qui passent », précise Jean-François Ghiglione (CNRS), directeur de recherche au CNRS et directeur scientifique de la Mission.

Les chercheurs et les étudiants engagés dans la Mission Tara Microplastiques ont travaillé d’arrache-pied pour compter les microplastiques dans nos fleuves. © Fondation Tara Océan
Des légions de microplastiques invisibles dans nos fleuves
Mais il n’est question-là que des grands microplastiques. C’est malheureusement peu étonnant. Parce que d’autres travaux ont trouvé ce type de chiffres pour d’autres fleuves dans le monde. Les plus pollués – le Nil (Égypte), le Yangtsé (Chine) ou le Gange (Inde) – atteignent même les 40 microplastiques par mètre cube. La vraie surprise est venue de ceux qui ne se voient pas. Des petits microplastiques. « En nombre, nous en avons trouvé 1 000 fois plus que les grands microplastiques. Et en masse, en moyenne, 35 fois plus. Parfois, jusqu’à 1 000 fois plus également. Il n’y a aucun autre polluant qui atteigne ces valeurs », révèle Alexandra Ter Halle. « Jusqu’ici, on regardait vraiment la partie émergée de l’iceberg », commente Jean-François Ghiglione.
Le chiffre est d’autant plus inquiétant que les petits microplastiques se retrouvent dans toute la colonne d’eau. Et qu’à cette taille, ils touchent tous les organismes vivants dans les eaux. Les chercheurs de la Mission Tara Microplastiques ont d’ailleurs étudié le cas des moules. Et découvert que leur respiration est altérée par la présence de microplastiques.

Les chercheurs ont aussi étudié les bactéries qui vivent sur les microplastiques. © Laboratoire Softmat, CNRS
L’autre découverte que les scientifiques ont faite, c’est que les agents pathogènes connus pour se servir des déchets plastiques comme de radeaux peuvent conserver leur virulence au cours du voyage. « Shewanella putrefaciens, une bactérie qui peut causer des péritonites, des otites ou encore des infections des tissus mous, reste virulente sur le plastique. Et il y en a sûrement d’autres. Parce que nous n’avons eu qu’à chercher pour trouver. Ça ne peut pas être un hasard », avance Jean-François Ghiglione. La dissémination des pathogènes par la pollution plastique est donc bel et bien possible. Quant à savoir s’il y a un risque pour notre santé, « il est trop tôt pour le dire ».
C’est pourtant la question que tout le monde se pose. La pollution aux microplastiques représente-t-elle un risque pour la santé humaine ? « Le concept de “santé globale” rend la question presque obsolète. Parce qu’il veut que tout ce qui a un impact sur notre environnement a, tôt ou tard, des effets sur notre santé », explique Henri Costa Bourgeois, expert sur les enjeux de la pollution plastique. Or la science l’a démontré, les microplastiques ont des effets sur l’environnement. Ils perturbent par exemple le développement et la reproduction des animaux.
Voilà pourquoi la Fondation Tara Océan milite pour une réduction de la production de plastiques. « En 15 ans, elle a été multipliée par 2 », note Jean-François Ghiglione. « Nous ne pouvons pas continuer comme ça. » D’autant que, et c’est l’un des autres résultats obtenus par la Mission, 25 % des microplastiques ramassés sur les berges des fleuves d’Europe sont en réalité des granulés de plastique industriels. Comprenez, des petites billes que l’industrie utilise pour fabriquer des objets en plastique. Une sorte de pollution primaire qui s’ajoute à la pollution secondaire. « Celle-ci ne vient pas seulement des déchets plastiques mis au rebut. Elle est disséminée dès le début de la vie des produits. Lorsque vous ouvrez et vous fermez une bouteille d’eau en plastique », explique Alexandra Ter Halle.
“La seule vraie solution face à cette pollution catastrophique, c’est de réduire notre production de plastique”
Ainsi lancer des opérations de nettoyage de l’océan ou des plages, améliorer le recyclage ou encore imaginer des plastiques biodégradables reste louable. « À condition de s’assurer de ne pas faire plus de mal que de bien. » Mais c’est un peu peine perdue. « La seule vraie solution face à cette pollution catastrophique, c’est de réduire notre production de plastiques », conclut Jean-François Ghiglione. Une idée qui fait son chemin dans les esprits des décideurs. « Il y a 10 ans, personne ne l’envisageait. Aujourd’hui, près de 140 pays signataires du Traité international contre la pollution plastique acceptent l’idée. »
Par FUTURA
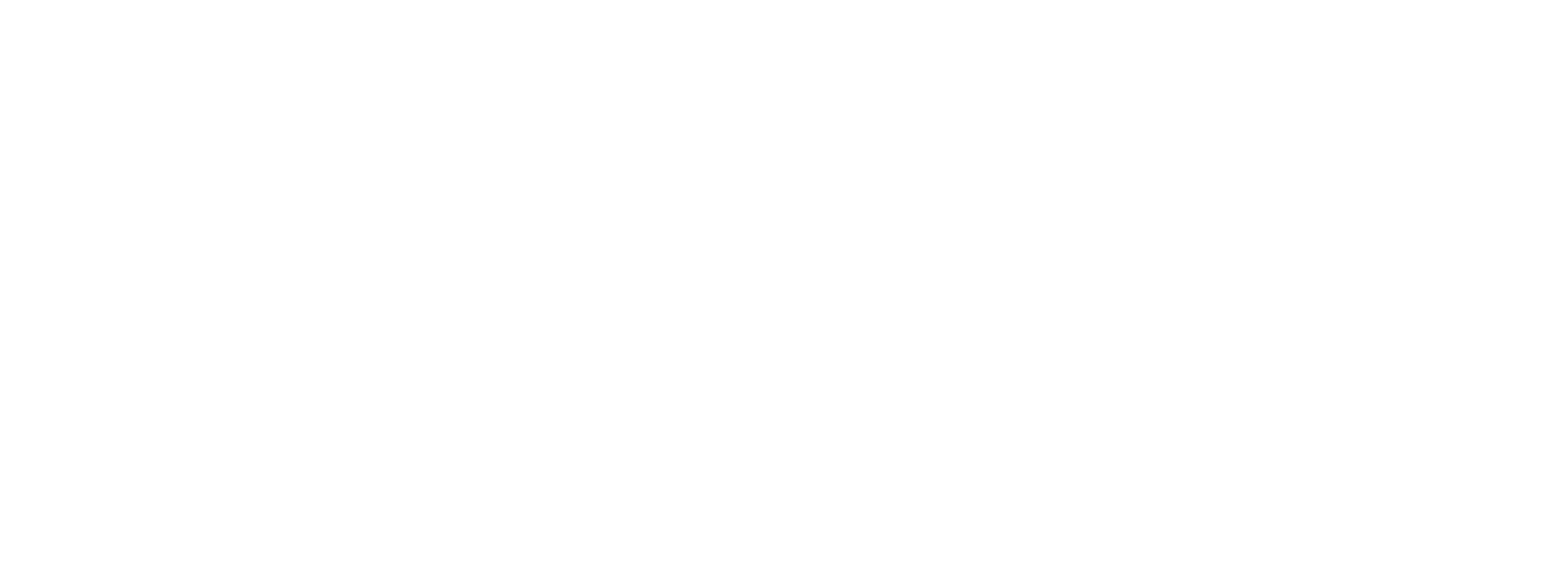













Commentaires