L’ex-champion de la NBA, sacré meilleur basketteur français de tous les temps, est aujourd’hui un homme d’affaires aguerri. Propriétaire d’un centre de formation, de remontées mécaniques, d’un haras et d’un domaine viticole, président et actionnaire majoritaire du club du LDLC ASVEL… Rien ne semble arrêter ce bourreau de travail, qui mêle depuis toujours discipline et passion.
HARVARD BUSINESS REVIEW FRANCE : Quand on a 9 ans et qu’on débute dans le basket, avoir un père ex-basketteur professionnel, est-ce un atout ou un défi ?
TONY PARKER : Cela a été un avantage car il m’a beaucoup aidé au niveau mental. Mais c’était aussi un défi car on a tendance, enfant, à vouloir battre son père. Je ne voulais pas le décevoir. Je me souviendrai toujours de la première fois où je l’ai battu. J’avais 16 ans, c’était à « un contre un » lors d’un événement Nike. Ce jour-là, j’ai su que j’étais prêt pour jouer en pro.
En 2001, vous êtes « drafté » par les Spurs de San Antonio et vous intégrez, à 19 ans, la NBA en tant que meneur de jeu. Une première pour un basketteur français…
C’était un rêve fou, c’est certain. Mais je me suis toujours dit : il faut un premier alors pourquoi pas moi ? Quand tu racontes ton rêve et qu’on ne se moque pas de toi, c’est que tu ne vois pas assez grand. J’avais envie de montrer aux Américains que les Français eux aussi savent jouer au basket.
Intégrer les Spurs, était-ce le Graal pour vous ?
La NBA est le rêve absolu de tout basketteur qui débute, mais on ne choisit pas forcément sa franchise. J’ai grandi en regardant les Chicago Bulls. C’était mon équipe préférée, Michael Jordan était mon idole. Mais j’étais très content d’intégrer les Spurs, avec des joueurs comme Tim Duncan (il a joué pendant 19 saisons chez les Spurs avec lesquels il a remporté cinq titres de champion de NBA, NDLR) ou David Robinson (un des meilleurs pivots et joueurs des années 1990, NDLR). C’était fabuleux pour commencer ma carrière.
Vous êtes le troisième Européen, mais le premier Français, à avoir intégré le Hall of Fame, en 2023. Comment vit-on une telle consécration ?
Cela a été une expérience unique. Je n’aurais jamais pensé que je puisse vivre cela un jour. J’ai toujours rêvé de marquer le basket français. C’est l’histoire de ma vie : premier Français champion de NBA, premier Français à être All-Star Game et ce Hall of Fame… C’est la consécration.
En votre hommage, les Spurs ont retiré le numéro 9. C’est aussi une belle marque de reconnaissance, après 17 ans passés dans cette équipe…
Cela fait chaud au coeur de se dire que personne ne pourra plus jouer avec le numéro 9. Quand je rentre dans la salle avec mes enfants, ils peuvent voir le maillot de papa au plafond. C’est extraordinaire. J’ai hâte de le revivre le 12 juillet, lorsque la Fédération française de basket retirera mon maillot de l’équipe de France, le numéro 9 aussi. Ce sera une première, tous sports confondus.
Vous êtes qualifié de meilleur joueur de basket français de tous les temps, meilleur passeur, meilleur marqueur… Est-ce une question de persévérance, de culture de la gagne, d’éthique de travail ?
Tout commence par le travail. Puis on développe une certaine discipline et éthique de travail. Il n’y a pas de secret : pour réussir, il faut travailler, être méthodique et persévérer. Le fait que mon père soit basketteur m’a aidé à acquérir la discipline nécessaire pour atteindre le plus haut niveau. Etant américain, il m’a aussi inculqué la culture de la gagne. Tandis que ma mère, en tant que naturopathe, m’apprenait à prendre soin de mon corps. Ce mélange favorise la longévité d’une carrière.
Vous êtes aussi un bourreau de travail. En 2006, vous aviez même engagé un « shot doctor », pour améliorer votre tir. Vous faisiez alors jusqu’à 200 paniers par jour…
Je voulais repousser les limites et continuer à progresser. Quand on commence à content de soi, c’est le début de la fin. La concurrence est rude, il faut essayer de se renouveler sans cesse. J’avais lu un article dans lequel le golfeur américain Tiger Woods disait vouloir changer son swing, pour être plus régulier, et parce qu’il était toujours à la recherche de la perfection. Cela faisait cinq ou six ans que j’étais en NBA. Je me suis alors dit que si Tiger Woods le faisait, je devais aussi pouvoir changer ma technique de tir pour devenir encore meilleur.
Quand avez-vous commencé à penser à l’après-basket ? Assez tôt, finalement, vers 25 ans…
J’y ai toujours pensé, mes parents m’ont éduqué ainsi. Très tôt, j’ai voulu rencontrer Magic Johnson qui, pour moi, était une référence en termes de reconversion dans le sport. Il m’a donné ce conseil : « Tisse ton réseau quand tu es en activité et à l’apogée. N’attends pas que tu sois à la retraite car tout le monde t’aura oublié. » Alors, au lieu de jouer à « Fortnite », comme d’autres, je rencontrais des P-DG. Deux ou trois chefs d’entreprise m’ont pris sous leur aile : j’écoutais, j’absorbais et je préparais l’avenir.
Vous êtes d’ailleurs devenu dès 2009 actionnaire de l’ASVEL…
Depuis mes 14 ans, j’avais envie de détenir un club de basket. J’adore la sensation de gérer un club, de développer une marque. Je suis aussi animé par la transmission, j’avais envie de redonner à la nouvelle génération. C’est pourquoi j’ai très tôt investi dans un club. Aujourd’hui, en tant que président, j’accompagne le coach dans le choix des joueurs, les transferts, la préparation physique… C’est moi qui ai le dernier mot. Et côté business, je développe la marque, je veille à fidéliser les clients. Il faut être bon en négociation, savoir lire un compte de résultat… Cela n’a rien à voir avec la carrière de sportif.
En 2019, vous avez annoncé votre retraite sportive à 37 ans. Cela a-t-il été difficile ?
Environ 95% des sportifs le vivent comme une dépression. Durant toute une partie de leur vie, on leur dit en permanence ce qu’ils doivent faire et lorsque, soudainement, tout s’arrête, cela peut être vertigineux. Dans mon cas, la transition s’est faite naturellement car je me suis plongé dans mes différents business. Je suis passé du terrain de basket au bureau sans difficulté. J’étais même très excité de vivre cette nouvelle aventure.
Entre 2019 et 2022, vous avez acquis des remontées mécaniques, un haras, un domaine viticole avec château, vous êtes devenu directeur général de Smart Good Things… Comment avez-vous acquis ce sens des affaires ?
J’ai appris sur le tas. J’ai toujours aimé ça, donc j’apprends vite. J’aime construire et faire grandir. J’ai un esprit d’investisseur et de bâtisseur. Et comme je n’ai pas l’impression de travailler, je ne compte pas mes heures. C’est vrai qu’il n’est pas courant pour un sportif de devenir homme d’affaires. Les chefs d’entreprises adorent collaborer avec d’anciens athlètes car ils sont capables de supporter une grande charge de travail, ils ont de la discipline. Je suis passionné par tout ce que j’entreprends, que ce soit dans le sport, l’éducation, l’art de vivre… Je ne pourrais pas faire que du basket. Je suis aussi très bien entouré. Je travaille avec les mêmes personnes depuis longtemps, ce qui crée une certaine stabilité et un climat de confiance.
Quel type de manager êtes-vous ? Plutôt fonceur et rapide, comme dans le basket, ou précautionneux parce qu’il s’agit du monde des affaires ?
Mon rôle est de fédérer les gens, de les faire adhérer à un projet. Je viens d’un sport collectif où chacun est un maillon clé. J’ai gardé cet état d’esprit. Tout l’enjeu est de mettre les bonnes personnes au bon endroit. Je suis le même dans le sport et le business : déterminé et prêt à repousser les limites.
Par Caroline Montaigne
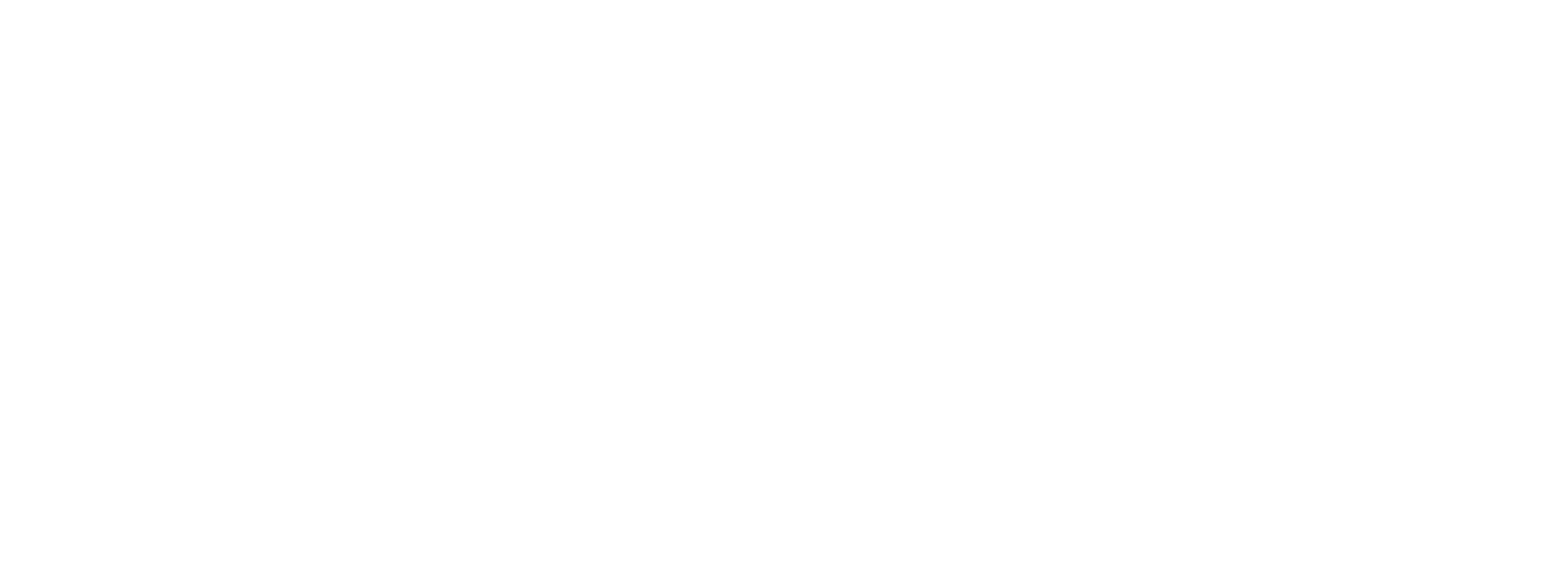












Commentaires