Il n’existe pas de formule magique pour faire du self-management une réalité, mais un chemin à suivre, semé de trois étapes fondatrices.
Même s’il est difficile d’y répondre, la question du self-management est pertinente pour beaucoup d’organisations. Sans surprise, il n’existe pas de solution miracle pour passer au self-management. Néanmoins, certaines étapes s’avèrent utiles pour cheminer dans la bonne direction. Cela commence par une véritable prise de recul et implique trois sujets fondateurs : le pari de la confiance et la question des croyances ; la structure de pouvoir (l’architecture qui permet de créer la culture) et l’énergie de la responsabilité. Une fois ces trois marches montées, les bases seront jetées.
Le pari de la confiance
La question de départ est la suivante : quelle conception de l’homme choisit-on d’épouser ? Jean-François Zobrist, directeur général de FAVI, s’est interrogé de la sorte lors de sa prise de fonction, en 1983. Sa réponse a été sans équivoque, rapide et radicale : l’homme est bon. Et puisque l’homme est bon, il a commencé par faire remplacer la vitre de son bureau, qui lui permettait d’observer et de surveiller l’atelier en contrebas, par un mur plein. Puisque l’homme est bon, pourquoi vouloir le surveiller ? Autre exemple : le stock, jusque-là fermé à clé par peur du vol, a été ouvert. Croire que l’homme est bon a donc un impact immédiat et majeur sur la réalité et le quotidien de chacun. Dernière illustration : un client, qui devait visiter l’usine située dans la Somme, est bloqué à l’aéroport de Paris. Il appelle son contact mais, à cette heure tardive, seule une employée chargée de l’entretien est présente. Elle décroche, prend conscience du problème et décide d’utiliser l’un des véhicules de l’entreprise pour aller chercher le client.
La démonstration est faite qu’en s’en tenant à ses croyances – l’homme est bon – et en les appliquant à l’organisation, il est vraiment possible de changer la donne. Aucune naïveté ou angélisme dans tout cela. Bien sûr, les vols, par exemple, ne seront pas totalement éradiqués. Pour autant, ils seront si peu nombreux qu’ils ne sauraient remettre quoi que ce soit en cause. Mieux, le vol sera d’autant moins compris et accepté par l’ensemble des acteurs que rien ne pourra vraiment l’expliquer et, a fortiori, l’excuser. En somme, qui dit self-management dit confiance. Et qui dit confiance dit croyance en un homme fondamentalement bon. Tel est l’un des préalables au cheminement de l’entreprise vers le self-management.
Cette croyance ne fait pourtant pas l’unanimité. En matière de travail comme en matière de philosophie, deux camps s’opposent. Le camp de ceux qui, comme Jean-Jacques Rousseau, affirment que l’homme est bon, naturellement bon et que c’est la société qui le corrompt. Le camp de ceux qui considèrent au contraire que l’homme est un loup pour l’homme (Thomas Hobbes). Indiscutablement, comme le souligne brillamment Rutger Bregman dans son ouvrage intitulé « Humanité. Une histoire optimiste », nos sociétés comme nos institutions ont plutôt fait le choix du second. Pourtant, toujours selon lui, la réalité est tout autre : « l’humain est bon, c’est scientifique ».
Une démonstration que l’on peut aussi rapprocher de celle développée par Douglas McGregor qui, dans ses travaux sur le monde de l’entreprise, affirme que le choix doit se faire entre la théorie X et la théorie Y, le parti pris de la « non confiance » versus le parti (on pourrait même dire le pari) de la confiance. C’est de ce dernier dont on ne peut se passer pour aller vers le self-management. Et pour y parvenir, la structure émerge naturellement comme le second pan du triptyque qui conduit au self-management.
La structure (en réseaux) crée la culture
Comme le souligne Marc Halévy dans ses travaux prospectivistes, nous n’avons d’autre choix que de passer de la pyramide à une structure en réseaux, à une organisation qu’il appelle réticulée. Et à la base de la structure, il y a le rôle, entité fondamentale d’où émerge la structure et le réseau. Ce dernier est, toujours selon Marc Halévy, « un ensemble structuré de petites entités autonomes en interactions fortes les unes avec les autres et fédérées par quelque chose qui est une identité commune et/ou un projet commun. » Le réseau est une façon adaptée de répondre aux complexités extérieures qui impliquent une nécessaire agilité.
On retrouve cette vision dans l’holacratie avec le rôle, pièce maîtresse de la constitution et du pouvoir constituant à déployer. Il est la base et permet de donner du sens. Il est un contenant, un atome ou une entité organisationnelle atomique qui permet de confier des mini-entreprises créatrices de valeurs à des personnes. Comme cet employé qui a la charge du design et de la formation – deux rôles qu’il incarne pleinement et en toute responsabilité. Le sens et les redevabilités en émanent naturellement. Ainsi, le fait d’avoir ces mini-entreprises en réseau nous fait entrer, par le jeu des relations client/fournisseur, dans un écosystème à l’intérieur comme avec l’extérieur de l’entreprise.
Dès lors, on change radicalement le paradigme du pouvoir. On passe d’une illusion du « pouvoir sur » à la notion d’empuissancement des personnes au service de leurs rôles. On passe d’un pouvoir limité à un pouvoir illimité, ou du moins seulement limité par la capacité des personnes à se saisir de celui-ci. La limite n’est pas structurelle ou managériale, mais liée à chacun dans le cadre de ses rôles. Finie donc la bureaucratie et vive la création de valeurs !
L’humain ou l’énergie de la responsabilité
Avec la naissance et l’émergence d’une nouvelle organisation, il est bien normal et essentiel de donner des rôles à chacun. Mais encore faut-il que chaque personne concernée veuille et accepte de les porter, de prendre en charge l’énergie de la responsabilité induite. Pas cette responsabilité qui se décrète (« Je te confie le rôle, tu en es désormais responsable »), mais une responsabilité qui est le fruit d’un échange énergétique au moment de la délégation. La personne qui prend en charge porte le sens, comprend de quoi il s’agit et souhaite avancer vers cet objectif sur lequel elle a pleinement conscience d’être attendue.
Bien sûr, dans une organisation, tout le monde n’est pas, d’emblée, prêt ou disposé à se saisir de cette énergie de la responsabilité. Prenons l’exemple de cette personne qui a un projet à mener mais le fait à la va-vite. Elle commet des erreurs et son travail ne débouche sur aucune des améliorations escomptées, alors qu’elle a les compétences requises. Elle n’a d’autre issue que de faire reprendre son travail par une tierce personne. C’est à ce dernier de prendre l’énergie de la responsabilité, de contrôler, modifier et améliorer le travail. Une situation qui, naturellement, débouche sur l’apparition d’un management, au sens du système conventionnel. C’est le manager qui endosse, amende et valide. L’enjeu du self-management apparaît dès lors clairement.
Et lorsque quelqu’un ne prend pas ses responsabilités, cela a souvent un impact sur les relations interpersonnelles, faisant inévitablement émerger le triangle dramatique (persécuteur-victime-sauveur), avec un clash probable entre le persécuteur – le manager mécontent – et le persécuté – celui qui n’a pas pris l’énergie de la responsabilité. Ici, le problème vient bien du « managé ».
C’est d’ailleurs pourquoi, dans la version 5.0 de la constitution d’holacratie, il est fait en sorte que ceux qui prennent cette responsabilité signent la constitution pour devenir des « associés », alors que les autres se voient offrir le temps et l’accompagnement nécessaires pour les amener, à terme, à faire leurs cette énergie qui irrigue l’organisation. Lorsqu’on parle ici de responsabilité, on parle d’énergie et non de compétences. Et à tous ceux qui sont tentés de rétorquer qu’ils ne prennent pas leurs responsabilités parce qu’ils ne voient pas comment faire, il faut dire que c’est une erreur. S’ils prennent l’énergie de la responsabilité, ils trouveront nécessairement le « comment ». Sur la voie du self-management, le principal défi consiste à inciter, à entraîner tous ceux qui ne se saisissent pas de cette énergie, qui ont une culture de la responsabilité encore trop faible, du fait de leur éducation ou de leurs peurs – notamment celle d’échouer.
Pour ceux-là, il faudra réussir à les faire dépasser leurs peurs. Il conviendra alors de créer des espaces protégés, dénués de jugement, dans lesquels les gens se sentiront à l’aise pour exprimer ce qu’ils ressentent. Une occasion inédite de créer un environnement fondé sur la confiance, préalable à toute forme de responsabilisation, mais aussi condition du passage à l’action, de la mise mouvement vers la création de valeurs et le self-management.
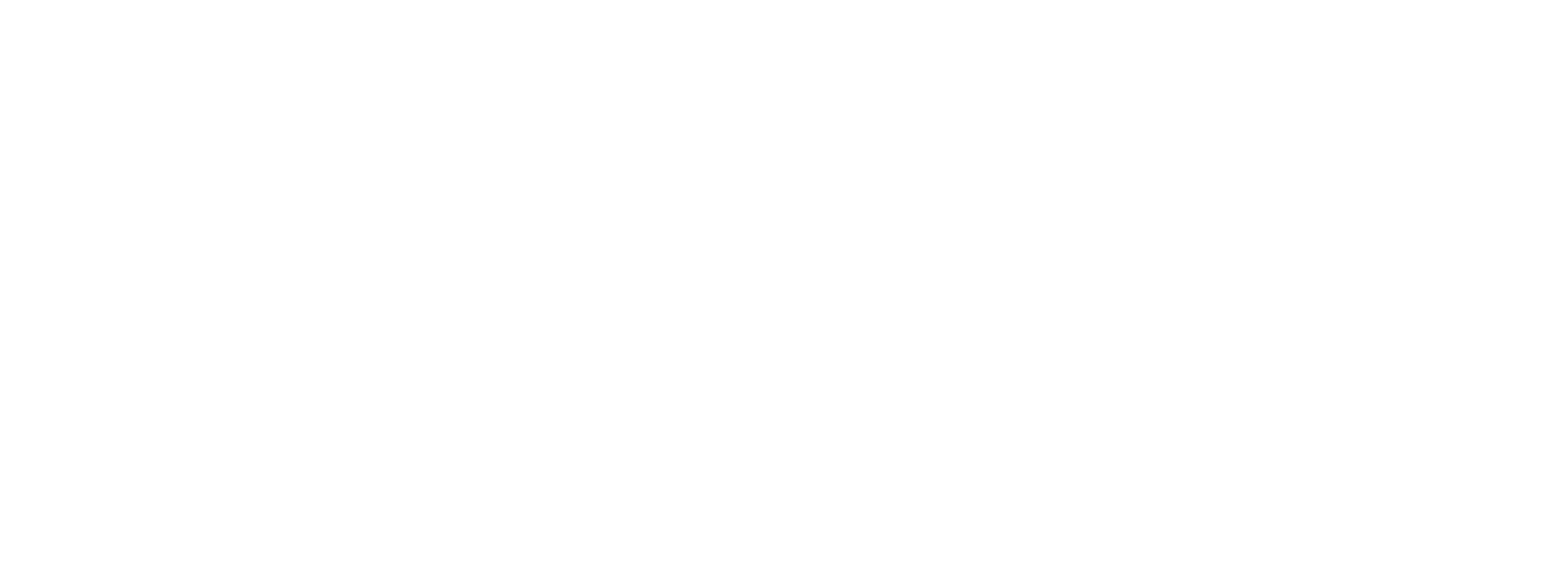














Commentaires