Par Julien Pelabere,Patrick Scharnitzky
Il est possible d’optimiser le fonctionnement de son cerveau pour réduire le risque d’erreur.
Aujourd’hui, les entreprises se veulent toutes agiles, créatives, réactives… Autant de caractéristiques qui nous obligent, dans un environnement de plus en plus complexe, à prendre davantage de décisions rapidement et avec peu d’informations. De quoi voir augmenter le risque d’erreur. Et ces erreurs ont un coût tant pour l’entreprise que pour l’individu lui-même.
Comment limiter ces erreurs ? Pour répondre à cette question, il faut prendre du recul et s’intéresser au fonctionnement de notre cerveau. Peu importe la terminologie employée, tous les chercheurs s’accordent à dire que notre cerveau dispose de deux modes de fonctionnement. L’auteur qui les présente de la façon la plus claire est certainement Daniel Kahneman avec sa théorie du cerveau à deux vitesses.
Nous disposons toutes et tous d’un cerveau lent, dit « rationnel », qui est capable de prendre des décisions logiques mais sous trois conditions : nous devons être motivés à ne pas nous tromper, investir de l’énergie mentale et physique, et bien sûr disposer de temps. Le reste du temps, nous utilisons plutôt notre cerveau rapide, dit « intuitif », qui est capable de prendre des décisions automatiques, très rapidement et sans effort.
Celui-ci reproduit des schémas acquis et produit des réponses adaptatives sans même que nous en soyons conscients. Notre cerveau rapide nous fait parler fort aux seniors, vouvoyer nos chefs, mais nous fait aussi recaler un candidat mal habillé sur l’autel de la fameuse « première impression qui est souvent la bonne », etc.
Alors comment optimiser notre cerveau lent pour réduire les risques d’erreur ? Quelles sont les conditions nécessaires pour qu’il puisse dicter sa loi au cerveau rapide et, surtout, quelles sont les questions à se poser avant toute décision importante ?
- Suis-je assez neutre émotionnellement ?
Les émotions peuvent être stimulantes ou bloquantes. Mais toutes sont polluantes pour la rationalité de nos prises de décision. A un instant T, une émotion, quelle qu’elle soit, encombre notre cerveau et nous prive de ressources. S’ensuit une décision potentiellement irrationnelle et liée à la nature de l’amorçage provoqué par la teneur même de l’émotion.
En clair, une bonne nouvelle nous rendra potentiellement plus sympathique et tolérant, un recadrage du chef peut durcir nos opinions et nous rendre intransigeant, et un mauvais chiffre peut nous plonger dans une posture pessimiste. Le principe de l’amorçage le démontre scientifiquement.
Dans une expérience de John Bargh, Mark Chen et Lara Burrows de 1996, des sujets étaient invités à compléter un test de langage consistant à reformer des phrases à l’aide d’une série de mots. Deux séries étaient utilisées, dont l’une composée de termes associés au stéréotype de la personne âgée (gris, vieux…). Les participants qui sont tombés sur cette série marchaient ensuite moins vite que les autres. Si l’effet ne dure pas, il montre bien que l’état émotionnel dans lequel nous sommes peut impacter nos actions.
- Ai-je vraiment envie d’être exact ?
Il faut une bonne dose d’humilité pour identifier la nature profonde de ses motivations. Si la décision que je suis sur le point de prendre est contraire à mon opinion initiale ou si elle remet en cause mes convictions ou l’image que j’ai de moi, serai-je vraiment prêt à la prendre, même s’il s’agit, à l’évidence, du choix le plus rationnel ? Pas sûr.
Dans une expérience de la chercheuse Susan Fiske de 1990, des salariés évaluent un faux candidat pour un poste à partir de son CV et de sa lettre de motivation.
Il est dit à la moitié des salariés que cette personne travaillera dans un autre département, à un autre étage et qu’ils n’auront jamais à travailler avec elle. A l’autre moitié, il est dit que cette personne partagera leur bureau les 24 prochains mois. Les seconds sont nettement plus motivés à être exacts et sont moins sujets à des biais liés par exemple à leurs idées reçues sur le sexe, l’âge ou la couleur de la peau. Pour décider rationnellement, il est donc nécessaire d’avoir l’humilité d’accepter ses biais.
- Ai-je les ressources nécessaires ?
Le cerveau lent est gourmand en énergie. Calculer, comparer et analyser sont des tâches cognitives coûteuses. Si cela peut sembler imperceptible au moment de la prise de décision, le cerveau, lui, est tout à fait au clair avec le fait que toute forme de fatigue ou de surcharge mentale le fait basculer en mode rapide et le pousse à utiliser des raccourcis et des biais décisionnels.
Nous risquons donc certainement de nous tromper davantage si nous sommes fatigués ou si notre cerveau est encombré par une autre activité.
Si vous répondez sans activer votre cerveau lent à la question « Une raquette de tennis et une balle de tennis sont vendues ensemble 110 euros, la raquette coûte 100 euros de plus que la balle, combien coûte la balle de tennis ? », il y a de grandes chances que vous vous trompiez.
- Suis-je assez informé ?
Le cerveau lent réfléchit. Il compare, synthétise, analyse et pèse le pour et le contre. Il a donc besoin de matière pour penser. Pour le rendre actif, il faut donc le nourrir de connaissances et de savoirs. Les RH sont par exemple prises au dépourvu face à l’émergence de revendications sur l’expression du fait religieux en entreprise. Peut-on l’interdire ? Faut-il l’autoriser ? Comment communiquer ? Ils sont perdus. Mais ils sont aussi souvent peu informés sur le sujet, que ce soit sur le fonctionnement des religions que sur le cadre légal. Or, ces deux niveaux de culture permettraient certainement de prendre des décisions plus sereinement.
- Suis-je prêt à sortir des normes ?
Enfin, toute décision rationnelle repose sur une posture a priori simple mais en réalité compliquée : le contenu d’une opinion doit être décorrélé de sa radicalité et/ou de sa fréquence. Autrement dit, une opinion rare ou radicale n’a aucune raison logique d’être fausse.
Or, notre cerveau ne l’entend pas de cette oreille. Il a accumulé des expériences et il est capable de faire des statistiques inductives. Il est donc nécessaire d’identifier le poids de la norme cognitive inconsciente. Mais il existe également en entreprise des normes sociales puissantes. Suis-je capable de prendre une décision quand je sais qu’elle ne rencontrera pas l’adhésion du collectif ?
C’est la question à laquelle répond une des plus célèbres expériences de psychologie sociale, que l’on doit à Solomon Asch (1954). Un groupe d’étudiants est invité à participer à un test de vision. Parmi les participants, un seul n’est pas complice de l’expérience. Lorsque les complices se trompent volontairement, les sujets dits « naïfs » se rallient au groupe et se trompent eux aussi plus de 30% des cas. C’est le principe même du conformisme. Nos décisions devraient résister à la pression des normes conscientes et inconscientes, mais encore faut-il que l’entreprise le permette.
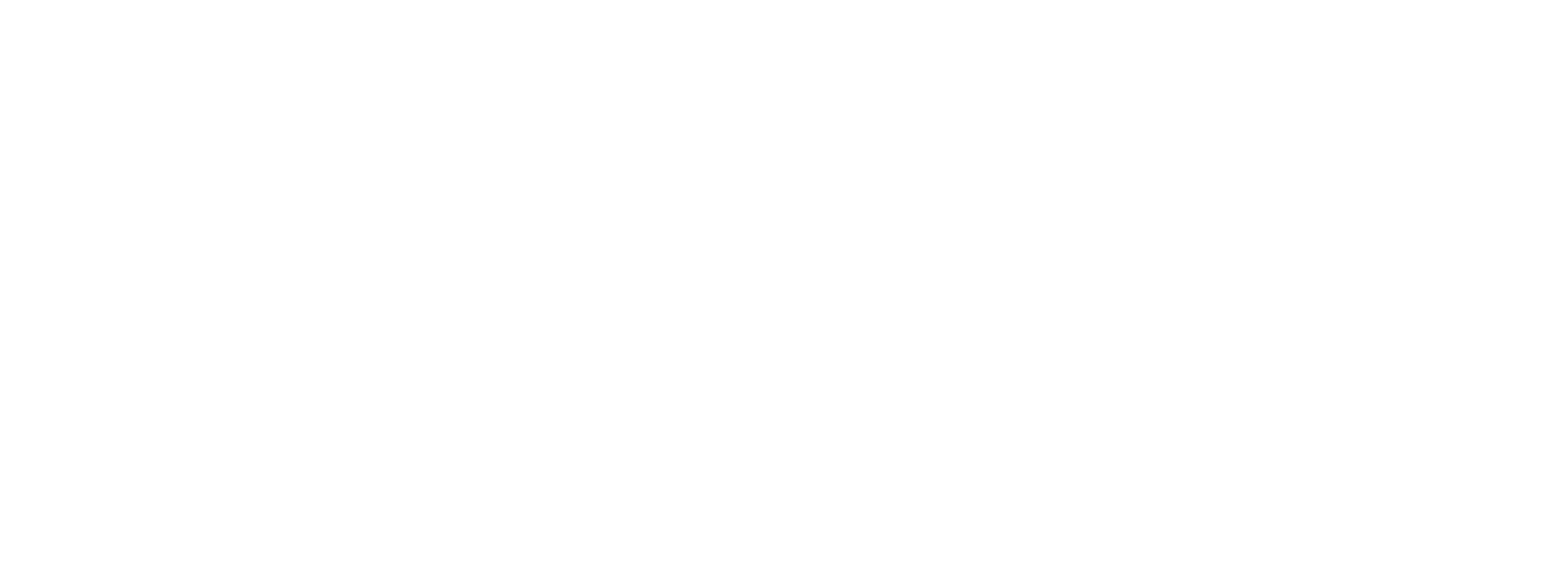














Commentaires