Depuis 2014, Mariam Issoufou Kamara partage sa vie entre les États-Unis et le Niger où elle dirige l’atelier d’architecture masōmī, au sein duquel elle développe des projets conciliant tradition, modernité et protection de l’environnement. Réchauffement climatique, crise économique, décolonisation des esprits : entretien avec une architecte engagée.
Par Stéphanie O’Brien
Forbes Afrique : Vous faites partie de la quarantaine d’architectes africains invités à la Biennale d’architecture de Venise, qui a pour thème « Le laboratoire du futur ». Que vous inspire ce thème ?
Mariam Issoufou Kamara : Je le trouve très approprié, surtout en Afrique où nous avons déjà l’impression d’être un laboratoire du futur. Que ce soit dans l’entrepreneuriat, l’art, l’architecture, la mode, je remarque que la génération actuelle s’est lancée dans un projet commun, avec l’envie de construire le futur que l’on désire vraiment pour le continent. Chacun de nous, à son niveau, essaie de trouver des réponses aux défis actuels, notamment environnementaux. Nous sommes parmi les moins pollueurs de la planète et pourtant nous faisons partie des premières victimes. Nous sommes confrontés à des problèmes qui ne sont pas encore arrivés ailleurs et pour lesquels nous devons trouver des solutions, nous sommes donc un laboratoire par nécessité. Pour nous, 2050, c’est déjà aujourd’hui.
Parlez-nous de « Process », l’installation que vous avez présentée à la Biennale ?
MIK : « Process » est une reproduction à la craie de peintures rupestres que l’on trouve dans les montagnes de l’Aïr, dans le Sahara, où je me rendais souvent avec mon père [Mahmadou Issoufou, ancien président du Niger, NDLR] lorsque j’étais enfant. Cette installation vient d’une introspection sur la question de l’appropriation des connaissances. Lorsque j’ai choisi de changer de métier et de devenir architecte, je me suis rendu compte que toutes les connaissances et les ouvrages sur l’architecture en Afrique se trouvaient principalement en Europe ou aux États-Unis. Cela veut dire que les gens qui vont en école d’architecture sur le continent n’ont pas facilement accès à ces documents et ce savoir. En Afrique, nous n’avons pas les ressources pour faire des recherches et documenter nos connaissances. Nous n’avons pas non plus les copyrights liés aux ouvrages, car ils sont détenus par les Occidentaux. Le fait de reproduire ces peintures millénaires sans demander d’autorisation est un acte de résistance, une provocation qui signifie que nous n’avons besoin de la permission de personne pour nous réapproprier notre histoire.
« L’architecture est un outil incroyablement puissant qui a un impact sur le paysage et l’environnement, mais aussi sur la psychologie des populations, et c’est ce qui m’a motivé à devenir architecte »
Cette mise en lumière d’architectes africains et issus de la diaspora, lors de la Biennale, est-elle un premier pas vers cette décolonisation des esprits que vous défendez ?
MIK : Oui, c’est un début et une belle opportunité, mais c’est surtout un travail psychologique qui doit être mené des deux côtés, en Occident et en Afrique. Pour ma part, j’ai eu la chance, durant mon enfance passée à Arlit, dans le Sahara, de découvrir la richesse de notre civilisation millénaire. Cela m’a permis de comprendre notre place dans l’histoire et sur cette planète. Cette perspective m’a permis de ne pas être influencée par la vision réductrice que les Occidentaux ont de l’Afrique. En tant qu’architecte, je contribue à déconstruire ce sentiment de supériorité absolu, qui permet aux Occidentaux de nous dire ce qui est bon ou mauvais pour nous et de maintenir dans une forme de colonisation. Aujourd’hui, la jeunesse du continent a le sentiment d’être dépossédée d’elle-même et d’être humiliée. Elle veut reconquérir le pouvoir de raconter son histoire et de diriger son avenir.
Et selon vous les architectes ont un rôle à jouer dans ce processus ?
MIK : Oui, parce que fondamentalement et depuis toujours l’architecture a servi à subjuguer, mais aussi à effacer. Quand on regarde une ville comme Niamey, c’est une ville qui a été construite pour la colonisation, c’est-à-dire pour le contrôle d’une population, pour l’extraction des ressources et leur acheminement vers l’océan via le fleuve Niger pour arriver en France. Aujourd’hui, la ville fonctionne encore comme cela, avec les nantis d’un côté et les classes populaires de l’autre. Les deux se retrouvent à jouer un peu les mêmes rôles sur l’échiquier, que les colons et – entre guillemets – les indigènes à l’époque. L’architecture c’est donc une réflexion, une vision de nous-mêmes ou des autres, en fonction de qui détient le pouvoir. C’est un outil incroyablement puissant qui a un impact sur le paysage et l’environnement, mais aussi sur la psychologie des populations, et c’est ce qui m’a motivé à devenir architecte. J’ai grandi avec un sens assez aigu de la justice sociale, et mon père répétait souvent cette phrase : ” Lorsqu’au terme de sa vie on se retourne et on se rend compte qu’on a vécu pour soi, c’est qu’on a gâché sa vie “. Cette phrase m’a marquée, et je considère naturellement qu’il est important de se mettre au service de quelque chose de plus grand que soi.
« À l’époque, quand je parlais de la terre crue, de ses propriétés thermiques, de son aspect culturel et identitaire, il y avait beaucoup de craintes et de réticences, car c’est un matériau considéré comme rural et arriéré »
L’architecture a également un rôle important à jouer face au réchauffement climatique et aux enjeux sociaux et économiques…
MIK : Oui, nous avons la chance de pratiquer un métier qui peut avoir un impact énorme, mais nous avons aussi d’importantes responsabilités. La filière de la construction représente 40 % de la pollution planétaire et notre rôle est d’apporter des propositions concrètes qui permettraient de causer moins de dommages à la planète. Je constate d’ailleurs que les clients sont souvent assez réceptifs à ce genre d’arguments, à condition que cela ne fasse pas exploser leur budget. Personnellement, je préfère mettre ma créativité au service de ce type de problèmes, plutôt que de la limiter à un exercice purement esthétique. Il existe dans chaque pays des matériaux, des savoir-faire traditionnels capables de répondre aux conditions climatiques locales. L’architecture contemporaine doit les moderniser et les pérenniser tout en innovant pour créer des associations sûres et résilientes.
Est-ce l’une des raisons pour lesquelles la terre crue est votre matériau de prédilection ?
MIK : Dans un pays comme le Niger, où il fait en moyenne 40-45 °C toute l’année, il est aberrant d’utiliser encore le béton qui retient la chaleur ! En 2014, quand j’ai créé atelier masōmī à Niamey, nous étions les seuls à construire des bâtiments en terre crue dans un contexte urbain. À cette époque, quand je parlais de la terre crue, de ses propriétés thermiques, de son aspect culturel et identitaire, il y avait beaucoup de craintes et de réticences, car c’est un matériau considéré comme rural et arriéré. L’enjeu était donc de démontrer que la terre crue pouvait être travaillée différemment et entrer dans la modernité. Le problème, c’est que nous avons intériorisé l’idée qu’être moderne, c’est être occidental, et cette uniformisation de l’esthétique nous appauvrit. Personnellement, le passé ne m’intéresse que pour mieux imaginer le futur, et être moderne, c’est vivre avec son temps tout en se projetant vers l’avenir. Mais les choses ont changé, et de plus en plus de clients choisissent la terre crue, parce que c’est beaucoup plus économique et que ça permet de limiter la consommation d’énergie. Nous sommes d’ailleurs en train d’achever un immeuble de bureaux qui sera le premier réalisé en terre crue.
« Le problème, c’est que nous avons intériorisé l’idée qu’être moderne, c’est être occidental, et cette uniformisation de l’esthétique nous appauvrit »
Vous avez fait vos études d’architecture aux États-Unis où vous vivez toujours, pourquoi installer votre activité en Afrique et au Niger en particulier ?
MIK : Après mes études, j’ai eu des propositions d’embauche, mais ça ne m’intéressait pas. Le seul architecte pour qui j’aurais aimé travailler, c’est Francis Kéré, mais il est installé en Allemagne et ça n’était pas envisageable. Et puis ce qui m’animait, c’était d’apporter ma contribution en Afrique. Je n’envisageais pas forcément d’avoir mon cabinet. Il était important pour moi de concevoir une architecture adaptée aux réalités locales, mais aussi de faire avec les moyens du bord. J’avais besoin de me prouver à moi-même que l’on était capable de faire les choses par nous-mêmes, même si j’en avais la certitude. D’ailleurs, l’équipe de masōmī est 100 % africaine. Nous avons des Nigériens, des Nigérians, des Sud-Africains, des Kenyans, des Centrafricains. Je souhaite démontrer que nous pouvons exporter notre expertise dans le monde entier et que nous ne sommes plus seulement des réceptacles de l’expertise étrangère.
« Je souhaite démontrer que nous pouvons exporter notre expertise dans le monde entier et que nous ne sommes plus seulement des receveurs de l’expertise étrangère »
Partager l’article
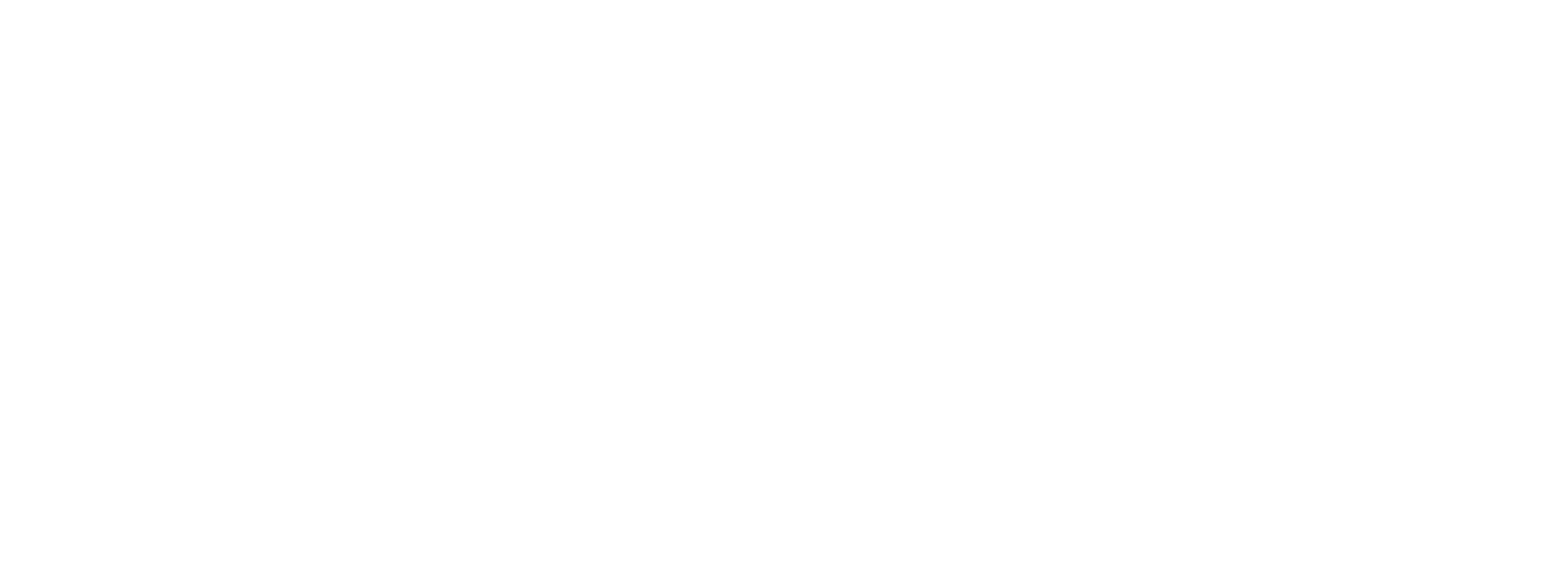














Commentaires